4. Shelley : L'Huitre
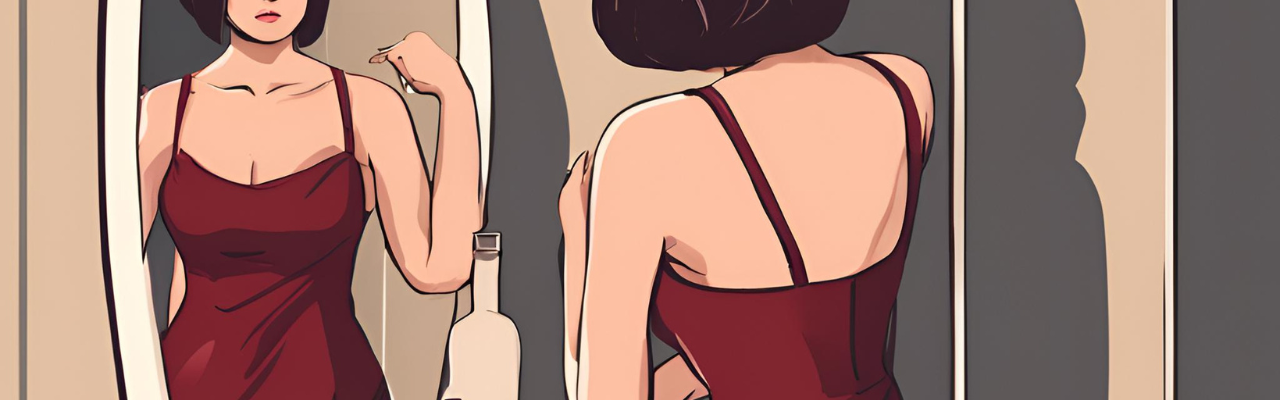
La vie, parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient à une chambre de l'hôpital des enfants de Potsdam. Ça tient au sol en linoléum orange, à un lit une place inclinable, à un stupide tableau représentant l'arbre de vie alors que vous crevez intérieurement.
Il y a un entre-deux lorsqu'on apprend une « mauvaise nouvelle ». On a des expressions stupides pour beaucoup de choses. « Mauvaise nouvelle », comme si je vous parlais simplement de votre équipe préférée qui vient de perdre le championnat.
Quand mon fils a cessé de respirer, les médecins m'ont annoncé la mauvaise nouvelle. Je me suis écroulée. Puis, j'ai ressenti un calme plat, comme si le monde s'était envolé, comme si plus rien n'avait d'importance. Alors, j'ai disparu. Mon corps était là, mais moi, vraiment moi – j'avais disparu.
J'ai disparu plusieurs fois dans ma vie. Pour me protéger. Pour survivre. Parce que, à ce qu'il paraît, la vie continue. La vie a continué après mon agression. La vie a continué quand j'ai dû taire qui j'étais en grandissant. La vie a continué après la mort de notre enfant. La vie a continué quand j'ai compris que mon mariage avait échoué. Elle a continué... plus ou moins. Peut-être que c'est juste ce qu'on se dit pour éviter de sauter sous un train.
J'ai eu des périodes où je me disais que j'étais forte de continuer, de me battre contre moi-même, contre la vie et ses balles courbes. J'avais de l'espoir. Puis, à d'autres moments, c'était comme si un trou noir aspirait toutes mes forces, toute la lumière.
Durant ces périodes-là, je m'éteignais. Je disparaissais davantage, jusqu'à n'être plus qu'un robot, un être artificiel qui faisait simplement fonctionner le corps. Encore une fois, pour ne pas finir sous un fichu train de la Deutsche Bahn*1.
Donc, parfois, la vie continue sans vous. Peu de gens s'en aperçoivent vraiment. Ceux qui vous connaissent le mieux... Et encore ! On vous dira : « Tu vas bien ? Tu n'es plus toi-même. » Ou encore : « Je ne te reconnais plus. »
Alors, lorsque mon fils a « disparu », la femme qui l'a porté a disparu avec lui. J'ignore où elle est, mais je sais qu'elle est encore en vie, quelque part. Parfois, lorsque mes barrières faiblissent, je la sens qui s'agite, qui menace le semblant d'équilibre que j'ai instauré ces trois dernières années. Je suis à la fois sa protectrice et son geôlier.
Peut-être que l'un ne va pas sans l'autre.
Lorsque j'ai un problème, lorsque je me sens mal, je marche dans les allées d'un cimetière. Je regarde les tombes défiler, sentant le poids du silence et des inconnus qui reposent sous terre. Des rangées d'âmes oubliées, de problèmes oubliés, d'idées oubliées, d'amours oubliés. En voyant cela, je relativise.
Un jour, ce sera moi dans l'une de ces tombes. Plus rien n'aura d'importance. Certainement pas ces deux tenues qui me fixent, immobiles.
Sur le lit, deux robes semblent se moquer de moi. La noire, sobre et élégante, qui épouse les formes avec un décolleté raffiné. L'autre, couleur lie de vin, plus courte et audacieuse. Encore en sous-vêtements, je me sèche les cheveux à l'aide d'une serviette. Je m'approche du miroir et observe mon reflet : mes défauts me sautent aux yeux, je ne suis pas ce qu'on appelle une fille « bien-faîte » selon moi. Je vois mes vergetures, mes cuisses qui se touchent un peu trop à mon goût, mon bas-ventre qui a perdu de son élasticité depuis la césarienne et qui forme une petite poche rebondie. Je déglutis en m'attardant sur cela. Lorsque je regarde trop mon corps, mon ventre, j'entends les cris de Lux comme s'il naissait à nouveau.
Pleure pas. Pleure pas ! je me dis. Tu vas abimer ton maquillage.
Mon visage dans le miroir semble me supplier. Me supplier de rester à la maison. Me supplier de grimper dans mon lit et de m'enterrer sous les couvertures, comme je sais si bien le faire.
Putain ! Ça y est j'ai tout foutu en l'air...
Je regarde mon mascara laisser deux longues traînées noires le long de mes joues. Je renifle fortement et me précipite dans la salle de bains pour limiter les dégâts. Je prends du coton et tapote doucement ma peau avant de rouvrir mon vanity-case et de fouiller à la recherche de quoi réparer la catastrophe.
Après quelques minutes, c'est comme si rien ne s'était passé. J'enfile la robe noire, mais elle me donne l'impression d'aller à un enterrement. J'essaye alors l'autre robe, et tire sur le tissus pour recouvrir mes cuisses le plus possible. J'oscille d'un talon à l'autre, mal à l'aise.
Souvent, j'ai l'impression qu'un homme sous la surface, regarde mon reflet en même temps que moi et qu'il se demande ce que je fabrique. Il ne se moque jamais, mais je ressens son malaise autant que le mien. J'ai l'impression de me travestir, de me déguiser lorsque je porte des choses très féminines, et je ne comprends pas toujours pourquoi. Lorsque j'étais adolescente et que ma mère m'a acheté mon premier soutien-gorge, je me souviens lui avoir dit après être sortie en le portant pour la première fois, seule dans la rue : « Maman, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression que tout le monde le voit. » Elle n'a pas compris pourquoi je ressentais ça, et je crois que, moi non plus à l'époque.
Mais, vous voyez ? Je m'égare encore une fois.
Je pousse une longue expiration en soutenant mon regard dans le miroir de ma chambre. C'est juste un rencard. Un stupide rencard... Ça ne t'engage à rien. En me disant cela, je me rends compte que j'y vais pour me prouver quelque chose et que je me fiche pas mal du gars que je m'apprête à rencontrer. Je n'en attends rien, je ne veux rien de lui. Puis je songe, peut-être que je me dis ça pour me rassurer. Je ne suis pas prête ! Je ne suis pas prête... Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fabrique ? J'ai rencontré Adrian il y a un mois par le biais de Mégane, lorsqu'elle a fêté son anniversaire. Nous avons parlé brièvement. Il est bel homme et a deux ans de plus que moi. Est-ce qu'il m'attire ? Non. Pas du tout. Mais mon psychiatre me pousse à « m'ouvrir », mes amis et ma famille me poussent à m'ouvrir. Alors je m'ouvre... comme une huitre qu'on force au couteau.
Je prends une grande inspiration et utilise le panneau de contrôle intégré à mon mur.
— Astra, j'ai besoin d'un holo-taxi. Commande Souleymane, s'il te plaît.
Une lumière bleue clignote, confirmant ma demande. Quelques minutes plus tard, une voix chaleureuse résonne dans mon appartement.
— Bonsoir, Shelley. Votre taxi est prêt.
Je laisse échapper un soupir, essayant de chasser les doutes. Tu vas y arriver, je me répète. J'attrape mon sac, jette un dernier regard dans le miroir et décide que c'est suffisant. Ce n'est qu'un rendez-vous. Rien de plus. Si ça se passe mal, je pourrai toujours partir.
Je descends les escaliers de mon immeuble sur Friedrichstraße, mes talons résonnant contre le marbre froid. Devant l'entrée, un taxi sans chauffeur m'attend. À l'intérieur, l'hologramme d'un homme turc d'une cinquantaine d'années, sourit derrière le volant.
— Salut, Mademoiselle Shelley, dit-il avec un sourire paternel. Prête pour ta soirée ?
— Autant que possible, Souleymane, réponds-je en m'installant à l'arrière.
— Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Où allons-nous ce soir ?
— Au restaurant Cumberland, s'il te plaît.
Souleymane acquiesce et le taxi démarre en douceur. Nous traversons la ville, les néons illuminant les rues. Pendant le trajet, Souleymane me parle de tout et de rien, essayant de me détendre.
— Tu sais, Shelley, tu es plus forte que tu ne le penses. Ce n'est qu'un rendez-vous. Tu es magnifique, et tu mérites d'être heureuse.
Ses mots me réconfortent, peu importe s'ils soient factices ou non : j'ai besoin de les entendre comme l'on a besoin d'air pour respirer.
Le taxi remonte le Kurfürstendamm*2 et s'arrête devant le restaurant Cumberland. La façade élégante, ornée de dorures et baignée de lumière douce, semble presque intimidante.
— Merci, Souleymane. À plus tard, dis-je en sortant.
— Bonne chance, Mademoiselle Shelley, répond-il avec un clin d'œil.
*1 Principale entreprise ferroviaire allemande.
*2 Avenue très huppée de Berlin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top