3. Voler la beauté
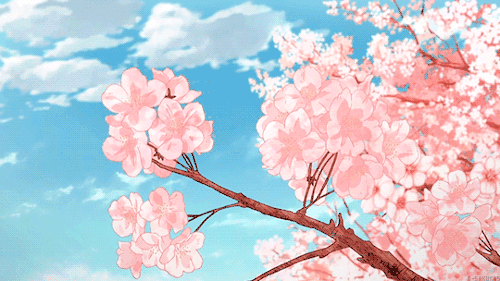
Voler la beauté
𓆸
Les habitudes sont pour la vie comme les mailles d'une chaîne. On peut les raccorder, puis les délier, les serrer contre soi sans jamais s'en défaire. Ou au contraire, tenter de les briser. Au fond, ces chaînes ne sont ni tout à fait des amies ni tout à fait des ennemies. Elles modulent simplement notre existence.
Il y a des chaînes plus longues que d'autres. Surtout celles des petits vieux. Mais c'est logique, ils ont vécu davantage, se fragilisent avec l'âge, accumulent les rituels pour contrer la vieillesse. Ma grand-mère est un parfait exemple d'habituée. Elle se couche toujours à la même heure, consomme le même kimchi, dans le même petit bol vert jade, et lit toujours les mêmes livres. Sur sa chaîne immense, l'habitude (ou devrais-je dire la maille) qui la caractérise le plus est celle du réveil. C'est frappant. À l'aube, quand tout le monde dort encore, elle quitte discrètement l'appartement. La porte se ferme derrière elle en un léger chuchotis. Elle sait rendre sa présence vaporeuse, ma grand-mère, mais parfois, les grincements du parquet la dénoncent.
Dès qu'elle n'est plus là, je cède à la curiosité en quittant mon lit. Puis, posté devant la petite fenêtre de ma chambre, la tête sous les rideaux, j'attends face au ciel d'agrume. Mon souffle répand sur la vitre une buée chaude. Quatre minutes plus tard environ, derrière ce voile qui se déploie puis se rétracte, sa petite silhouette reconnaissable apparaît dans le parc, en contrebas. Seule, elle fait le tour de l'étang qui porte encore la nuit dans ses entrailles brunes. Par moments, elle s'arrête au bord de l'eau, fixe les tourbières éclairées par l'aurore, et repart tout doucement en resserrant contre elle son petit gilet vert.
Je ne comprends jamais ce qu'elle y fait. Ça semble juste important, et c'est suffisant pour attirer mon attention.
Parce qu'on dirait un secret. Quand je vois ma grand-mère, j'ai l'impression d'avoir une chaîne de petit vieux. Juste comme elle. Mes habitudes sont nombreuses. Dans ma chaîne à moi, il y en a une qui ne me lâche pas : c'est mon goût irrépressible pour les gribouillages. Je passe mon temps à dessiner n'importe quoi, n'importe où. Dans ma chambre ou dans le salon, au lycée ou près d'un parc, dans le métro... C'est plus fort que moi. J'égare tout sur mon passage.
Hier, par exemple, ma mère m'a sermonné pendant toute la soirée au sujet de ces « fichus papiers volants qu'on retrouve près du lavabo de la salle de bain ou dans le frigo ! ». (Pour sa défense, elle n'a jamais vraiment eu la fibre artistique.) À chaque fois, je subis ses réprimandes et récupère mes petits dessins la mort dans l'âme. Et comme ça me fait toujours un peu mal au coeur de m'en débarrasser, j'ai pris l'habitude de les scotcher sur les murs de ma chambre. Le résultat me plaît bien.
Parfois, installé à mon bureau ou sur mon lit, je lève les yeux pour les contempler, et à la place de ce havre qui n'est fait ni de paix ni de tranquillité véritable, mais qui commence au moins à porter un peu de mon empreinte, j'imagine ma chambre de Busan.
Je repense aussi à mes autres habitudes, laissées là-bas. Jouer avec Minho et les autres, flâner sur la plage de Haeundae, manger des galettes de haricots... Et toujours, ces dessins. Il fallait me voir à l'époque, pendant l'école primaire, quand ma maîtresse nous emmenait en atelier d'arts plastiques tous les mardis après-midi. Une liesse irrépressible montait en moi dès que j'entrais dans cette salle immense, avec ses baies vitrées d'où venait toute la lumière du jour. Ça me donnait envie de courir partout. Ce que je faisais allégrement, me préoccupant peu des réprimandes de madame Lee. Et, quand j'en avais assez ou qu'elle m'attrapait enfin, je m'affalais contre une vitre froide, puni pendant de longues minutes, face à la ville étriquée que j'aimais contempler.
Busan courait, elle aussi. Elle courait vers la mer. Et la mer remuait mollement à ses pieds, comme ces chiens domestiques un peu paresseux mais contents de retrouver leur maître. Ou peut-être était-ce la mer, le maître, et Busan, l'animal.
J'ai tant de souvenirs enfermés dans cette pièce. Il y a l'été, à la chaleur si terrible que l'encre bavait sur nos mains. Il y a l'hiver, qui faisait trembloter nos crayons. Mais surtout, pour moi, il y a la beauté volée. Je n'étais pas très doué en arts plastiques alors que j'adorais reproduire tout ce que je voyais : le parc où j'allais jouer, le sourire de maman, les jolis beignets sucrés qu'on cuisinait parfois... Je faisais de mon mieux, je suppose. Jusqu'à ce jour inoubliable où ma maîtresse nous a fait découvrir le papier-calque. Le principe de repasser sur les traits d'un dessin pour les recopier sur un support vierge m'a subjugué.
Très vite, j'ai commencé à tout calquer : photos, paysages derrière une fenêtre, illustrations dans les livres de contes... Je ne faisais plus que ça.
On a même fini par m'appeler le copieur. Moi, je me voyais plutôt comme un voleur.
Calquer, c'est voler la beauté, l'emporter avec soi comme un trésor sans le dire à personne et la laisser vivre ailleurs.
Aujourd'hui, je suis ce même voleur. Après une première semaine aussi froide et triste que l'hiver, après une vertigineuse sensation de vide, parce qu'à Busan, j'étais plein, j'essaie de voler la beauté de ma ville pour la poser sur celle-ci.
Busan est mon calque ; Séoul, ma feuille blanche ; mes yeux, le crayon.
Je veux coller une effervescence familière là où va mon regard.
Croire peut-être qu'un résidu de cette beauté survit ici.
Alors je calque. Je calque la mer du Japon sur l'immense berge du fleuve Han chaque jour dans le métro. Je calque le village de Gamcheon sur les ruelles colorées de Mapo. Je calque l'odeur des brochettes de bulots au marché de Jagalchi sur le fumet des viandes qui embaument le coin des restaurants.
Ces petits jeux ne sont qu'une tentative pour moi d'effacer Séoul de ma tête. J'ai besoin de croire que je ne vis pas ici.
Les cours de physique-chimie sont un désastre. On n'entend que les pages de manuel se tourner et les soupirs dépités de monsieur Han, qui finit toujours par interroger ce même garçon du troisième rang, dont la voix m'est inconnue. Son nom aussi m'échappe ; peut-être parce que je préfère dessiner dans mon cahier pendant l'appel. Je n'ai jamais vraiment vu son visage. Il bouge toujours trop vite, évite à peu près tout le monde, sauf Yejun, le populaire qui fait craquer les filles. À bien les observer, ces deux garçons forment une drôle de paire.
Toujours est-il que ce mystérieux camarade, à l'air vague et taciturne, relève notre niveau pitoyable. À chaque fois, dans un silence olympien, il résout les problèmes les plus complexes au tableau, avant de retourner à sa place avec une amère désinvolture, faisant fi des compliments du professeur. Cette scène a tout d'une habitude pour lui.
Chacun ici, à vrai dire, se trahit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il y a Sungil qui continue de me regarder étrangement, Eunha qui braille plus fort que certains garçons de la classe, Mina qui collectionne les gommes Kuromi. Il y a ma grand-mère et ses promenades secrètes, moi et mes gribouillages, et puis il y a eux, mes camarades.
Depuis que je vis à Séoul, ma chaîne d'habitudes s'allonge. J'épie ma grand-mère le matin, je choisis toujours la même rame de métro, et maintenant... je mange devant le terrain de basket du lycée. J'ai fait du couvert d'un arbre mon refuge. Adossé contre son tronc, je me fonds dans l'ombrage des feuilles qui vibrionnent, tel un figurant plongé dans les coulisses. De toute façon, les garçons qui se retrouvent là-bas le midi sont trop pris dans l'action pour faire attention à moi. Leurs jacassements tapent fort par-dessus les balles rebondissantes pendant que j'avale mon déjeuner et rêve de recracher leurs éclats tonitruants.
Ces garçons me rappellent Busan, et ce, depuis le premier jour. Au fond, je sais qu'ils m'attirent avant tout pour ça.
À force de venir, je commence à en reconnaître certains. Ils sont tous en terminale.
Le garçon au bandeau rouge se distingue toujours des autres par son calme qui trompe bien son jeu agressif. Jamais il ne crie, jamais il n'éclate de rire. Mais son corps dégage une énergie terrassante, le genre d'énergie qui brûle de hargne. À plusieurs reprises déjà, je l'ai surpris en train de tourner vaguement la tête vers moi. Parfois, j'espère qu'il vienne me parler, mais quand j'y songe sérieusement, les petits poissons dans mon ventre s'activent comme des beaux diables.
J'imagine donc que cette situation me convient. Ce jeudi midi, je ne vois pas venir la reprise des cours et la sonnerie me fait me lever comme un ressort. Aujourd'hui, les joueurs présents se sont déchaînés pendant plus de quarante minutes, me laissant admiratif, presque en transe. Le garçon au bandeau rouge n'est pas venu, lui. Tout du long, je me suis demandé ce que ça donnerait de le voir au milieu de cette fosse aux lions. Les aurait-il tous écrasés ?
Tandis que je traverse la cour sans faire attention au monde autour de moi, j'entre en collision avec quelqu'un. L'impact me propulse en arrière, et mon sac se déverse sur le sol. Quand je me relève, les joues rouges, des excuses au bord des lèvres, je reconnais le garçon au bandeau rouge.
― Fais attention, prononce-t-il sans lever les yeux, ramassant calmement mes affaires.
Aujourd'hui, ses cheveux noirs retombent lourdement sur son front, sans rien pour les retenir. C'est la première fois aussi que je le vois avec sa veste d'uniforme. De près, il paraît plus jeune, et se révèle bien plus grand.
― Désolé.
Dévoré par la gêne, je récupère mon sac, m'incline bas devant lui avant de filer vers mon bâtiment sans un mot de plus.
En rentrant de l'école, je ne trouve ma grand-mère ni en bas de l'immeuble, ni dans le parc près de l'étang, ni dans le salon. Ma mère, l'expression froide et dévastée, sirote une tisane dans la cuisine.
Elle m'accueille dans un silence inquiétant. D'habitude, je file sans un mot dans ma chambre, mais cette fois-ci est différente. Je le sens : nos chaînes sont rompues. Seulement l'espace d'un court instant, j'espère. Car les habitudes, si elles semblent ennuyeuses par moments, rassurent aussi. En m'approchant de ma mère dans la cuisine, je saisis dans ses yeux quelque chose d'inhabituel.
Un éclat de ruine.
― Elle est très malade, souffle-t-elle comme si elle entendait ma question muette.
Impuissant, je m'installe devant elle, sur ce minuscule tabouret en bois que je déteste mais que je prends toujours. Question de respect aux aînés.
― On est allées à l'hôpital aujourd'hui, reprend-elle en pianotant nerveusement sur la table. Et le cancer est trop avancé pour faire quoi que ce soit. De toute façon, elle est trop âgée.
Ma mère ne m'a jamais semblé très proche de la sienne, néanmoins à cet instant, je décèle un attachement profond pour elle.
― Où est-elle ?
― Dans sa chambre. Elle dort.
Un soupir éreinté quitte ses lèvres. Ses yeux, troubles de larmes, dévient sur le contenu de sa tasse. Dans mon ventre, les petits poissons se blottissent les uns contre les autres.
― J'ai... Je voudrais remonter le temps. Lui dire certaines choses.
Des choses que je ne voulais pas dire plus jeune, par fierté, par colère. J'ai tellement... Sa voix se brise. Mon coeur se fige.
― J'ai tellement de peine pour elle. Tellement, tellement, tellement...
Un sanglot lui déforme la voix. Muet, je ne bouge pas. Je la laisse se calmer, car c'est ce qu'elle préfère quand l'émotion la submerge. Un long silence passe entre nous, durant lequel elle reprend une gorgée de son thé. Moi, je n'ose pas quitter mon petit tabouret, le sac toujours sur le dos, un peu voûté. Fugacement, je me dis que je n'ai pas qu'une chaîne de petit vieux.
― Qu'est-ce qu'elle fait tous les matins ?
Ma question, sans rapport, et qui paraît presque insensible à la tristesse du moment, laisse ma mère impassible. Jusqu'à l'arrivée d'un éclair taquin dans ses iris sombres.
― Elle cherche des rhizomes. Ce sont des racines de lotus. Ta grand-mère adore ces fleurs.
Je ne suis pas qu'un voleur, je suis un lâche. Depuis cette discussion avec ma mère, j'erre. Une nouvelle maille vient s'ajouter à ma chaîne.
Le lendemain, après les cours, je déambule au pied de la tour Namsan et contemple la ville en contrebas. Une fois la nuit tombée, j'ai l'impression que tout redescend en moi. Mon esprit s'apaise, le calme devient plus supportable. Alors, je continue mon exploration des parcs.
Samedi, je pars à celui de l'Olympique et de Haneul. Dimanche, c'est au tour de Yeouido Hangang de recevoir ma visite. Celui-là me fait forte impression. Plus que les autres. Repassé par le béton et l'herbe trop piétinée, il s'allonge contre le fleuve Han et ferme les yeux sous le soleil du printemps. J'aime passer sur son corps. C'est bien celui qui me plaît le plus.
Je n'arpente pas que les parcs cela dit. Lundi, après les cours, je passe dans les rues de Jongno... Là-bas, j'entends mon nom crié à pleins poumons. Les Jaewon ne manquent certainement pas dans une ville comme Séoul. À vrai dire, rien ne manque ici, sinon la beauté de Busan.
Et c'est le plus précieux, pour moi. Alors je continue de voler. Je continue de calquer. Mes escapades nocturnes me font rentrer toujours plus tard. Ma mère n'en dit rien, submergée par son travail et toutes les tâches du quotidien, pour elle, pour ma grand-mère, pour moi. Au fond, je ressens une profonde culpabilité à la voir s'épuiser de la sorte. J'aimerais pouvoir l'aider, mais quelque chose m'empêche de rentrer tout de suite après le lycée. En parcourant Séoul, je me fais l'effet d'un garçon perdu qui ne sait même pas ce qu'il recherche.
Ce lundi soir, je trouve en bas de l'immeuble assis sur un muret en pierres un petit bonhomme, de même pas dix ans. Quand je passe près de lui sans rien dire, son regard m'attrape.
― Tu veux une glace, hyung ?
Freiné dans mon élan, je tourne la tête vers lui. Dans sa petite main repose l'emballage d'un esquimau au beurre. Je grimace.
― C'était la promo « un acheté, un gratuit », ajoute-t-il en haussant les épaules. Mais j'en veux plus.
J'hésite, me mords la lèvre avant d'accepter sur un coup de tête.
― T'es qui, sinon ? me questionne-t-il naturellement pendant que je m'installe à ses côtés en déballant ma glace, à moitié fondue.
Ça doit faire un petit moment qu'il est là.
― Je m'appelle Jaewon. Et toi, c'est quoi ton prénom ?
― Minho ! clame le garçon en souriant largement.
― Oh... Je connais un autre Minho. Jin Minho. Il habite à Busan.
Je repense à Minho et ses copains de l'immeuble, avec qui on jouait pendant des heures, sous un soleil de plomb.
― Moi c'est Kang Minho ! Il est comment ton Minho ?
― Il est petit, et il adore la mer. Il a peur de l'école aussi.
Le garçon me fixe, les yeux écarquillés avant de passer du coq à l'âne.
― C'est joli le grain de beauté, là !
Son index tout collant de glace se pose sur le coin de mon oeil.
― Merci, je réponds sans m'écarter. J'aime bien ton short.
Il me sourit avant de s'éloigner et de balancer ses jambes nues dans l'air.
― Tu es nouveau dans l'immeuble, hein ? Tu viens de Busan ? Il est où ton papa ? Je le vois jamais.
Je papillonne des yeux, étonné. Visiblement, lui nous a souvent aperçus, ma mère et moi...
― Il est mort quand j'étais petit.
― Oh... C'est triste, dis donc. Moi, mon papa, il est pas souvent là à cause de son travail. Dis, tu voudras bien jouer avec moi un jour ? Il y a un de mes copains qui a déménagé. C'est pas cool. Tu pourrais devenir mon nouveau copain de jeux, et moi, ton nouveau Minho, non ?
Le Minho de Séoul. J'esquisse un sourire attendri. Les enfants ont parfois une façon si simple de penser. Penser comme un enfant... Finalement, c'est peut-être ça qu'il me manque encore ici, plus que la beauté de Busan. Peut-être devrais-je voler un peu du coeur de cet enfant-là, pour le mettre dans le mien.
― J'en serais très heureux.
𓆸
(J'aime trop Minho mdrrrrrr) ♡
Forlasass
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top