Voulez-vous coucher chez moi, ce soir ?
Le vent se lève et souffle les arbres, la température d'abord agréable est maintenant fraîche.
— On fait quoi maintenant ? demande-t-il.
Je me gratte la tête.
— Je suppose que l'on attend, lâché-je, peu convaincu.
— On attend quoi ? Qu'il vienne nous voir et nous dise : venez voir mon bébé et donnez-lui le remède afin que l'on sauve le village ?
Un point pour lui. Il n'y aura jamais d'occasion parfaite qui se présentera.
— On pourrait essayer de calculer les durées moyennes de ses absences ? je demande.
— Tu t'y connais en mathématiques ? s'étonne-t-il.
Je hausse les épaules. Savoir faire une moyenne, ce n'est pas ce qu'on appelle être un as en math à mon époque. Mais il faut croire que ce n'est pas le cas pour le siècle où j'ai atterri.
— Oui, assuré-je.
Cela m'étonnerait beaucoup qu'il me donne à réciter les théorèmes de Pythagore ou de Thalès pour lui prouver mes dires.
Nous nous installons sur un banc donnant vue sur la porte, à quelques mètres de là. Depuis que je suis arrivé dans la ville, je peux certifier qu'Alois est sorti au moins deux fois de chez lui. Et si je sais à peu près le temps de sa première sortie - environ une heure trente - je ne sais pas pour la deuxième.
— Et si on toquait à la porte et qu'on lui expliquait simplement la situation ? Il fait peut-être parti des forces de l'ordre, mais il peut très bien croire aux visions venant du futur.
Je tressaille, il manquerait plus que ça. Même si Alois me croyait, son bébé finirait par mourir et je crois que le lien entre mon pseudo-remède et la mort de son cher enfant sera assez rapide à faire. Imaginez être exécuté pour un petit meurtre de rien du tout, alors que vous avez sauvé la vie de millions de personnes !
— Non, il est préférable qu'il ne sache rien. On ne sait jamais, déclaré-je, sans ajouter une quelconque explication.
Il hausse les épaules.
— Nous voilà donc à la case départ. Attendons quelques heures et nous verrons bien ce qu'il se passe, lancé-je, las.
Installés sur le banc, nous rêvassons, silencieux. Les nuages gris ne sont même pas cotonneux. Compacts et obscurs, ils prédisent la pluie et l'orage. J'ai bien peur de me retrouver rincé, une nuit de plus. Le temps passe lentement, les nimbus s'assombrissent et l'horloge solaire n'indique plus l'heure. Foutu pays. Foutue époque.
La chair de poule a gagné mon petit corps de Français chouchouté. Ce que je donnerais pour avoir un plaid tout doux sur les épaules. Je me rappelle soudain la montre à gousset dans ma poche, je la sors. La chaîne argentée brille sous l'ombre des cumulonimbus.
Dix-sept heures trente est affichée. Le soleil ne va pas tarder à se coucher et rien ne se passe.
— Je pense qu'il ne ressortira pas ce soir, ponctue-t-il, nous devrions rentrer.
Cette phrase me fige. La vision d'une nuit dans la rue est loin de me réjouir. Raidis, j'attends.
— Où comptes-tu dormir ce soir ? me demande-t-il complètement innocemment.
Mes pensées contradictoires se font la guerre. Puis-je lui dire la vérité et donc, vu son éducation, le contraindre à m'héberger ? Ou dois-je mentir et ainsi, finir par m'assoupir sur ce banc ? La bonne conscience qui parfois m'anime, s'éteint en pensant au froid et à la faim qui m'attendent en choisissant la deuxième option.
— Je n'ai nulle part où aller, pour l'instant.
Il s'arrête, il est presque plus statufié que moi.
— Je croyais que vous, les nomades, saviez par avance où dormir pour la nuit.
— Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire les choses au dernier moment, souris-je.
J'adopte une attitude détendue - du moins, j'essaye - alors que la peur coule dans mes veines comme de l'alcool dans celles d'un poivrot.
Je sens le doute l'envahir. Ses valeurs, les mœurs et ses préjugés se confrontent. Je ne lui demanderai pas si je peux venir dormir chez lui. Il a déjà très bien compris le sous-entendu. Il est hors de question que je le mette encore plus mal à l'aise.
Puis après une longue minute de réflexion, Anatole baisse finalement les yeux avant de les relever :
— Voulez-vous coucher chez moi, ce soir ?
Ma bouche forme d'abord un o de surprise. Il faut que je répète deux fois la phrase dans ma tête pour bien la comprendre - vous devinerez aisément avec quelle question j'ai bien pu la confondre - la chanson du cabaret le Moulin rouge : Lady Marmelade, résonne dans ma tête et j'essaye de la faire taire pour ne surtout pas la fredonner. Ce serait extrêmement déplacé.
— Ce serait très généreux de ta part, déclaré-je.
Sans discuter, nous nous remettons en mouvement tous les deux et je le suis, baluchon à la main. Des gouttelettes se forment et glissent de temps à autre sur nos fronts et nos nez. À ses côtés, la marche est agréable, le silence entre nous n'étant ni pesant, ni dérangeant.
Après avoir déambulé durant un long instant, nous atteignons les environs d'une ferme. Des briques marrons recouvrent la façade et des meules de foin barrent l'horizon. Nous approchons, avant qu'Anatole ne se saisisse d'une cordelette et ne fasse tinter la clochette.
Un instant plus tard, une bonne femme aux allures aussi sympathiques que l'affreuse dondon, vient nous ouvrir. Elle est grande, robuste et son visage carré est tiré par la fatigue. Elle nous fait signe d'entrer et n'ajoute aucun mot. Anatole la salut de son chapeau et me conduit à une porte en bois dont il s'empresse de déverrouiller la serrure.
— La ferme appartient à ta famille ? questionné-je.
À l'intérieur, le poêle est chaud et la température, très confortable. Quelques meubles de bois décorent la pièce et une bibliothèque fournie recouvre le mur. Comparé à la demeure où j'ai dormi la veille, on sent que l'argent y est plus présent.
— Non, je loue pour quelques pièces cette chambre à madame Zimmer. J'ai toutes les commodités, et même une baignoire.
Ils ne sont donc pas tous sales ! crié-je à moi-même.
— Tu vis seul ?
Il acquiesce, l'air un peu triste.
— Je n'ai pas vraiment de famille. J'ai été en foyer jusqu'à un âge avancé, mais j'ai eu la chance d'être recueilli par une famille catholique qui avait les moyens de m'éduquer lorsque j'eus douze ans. Ils sont morts l'année dernière.
J'opine du menton, ne sachant que dire.
— Merci de me loger pour la nuit en tout cas, déclaré-je.
Anatole me répond par un simple sourire, celui-là même qui me donne des frissons.
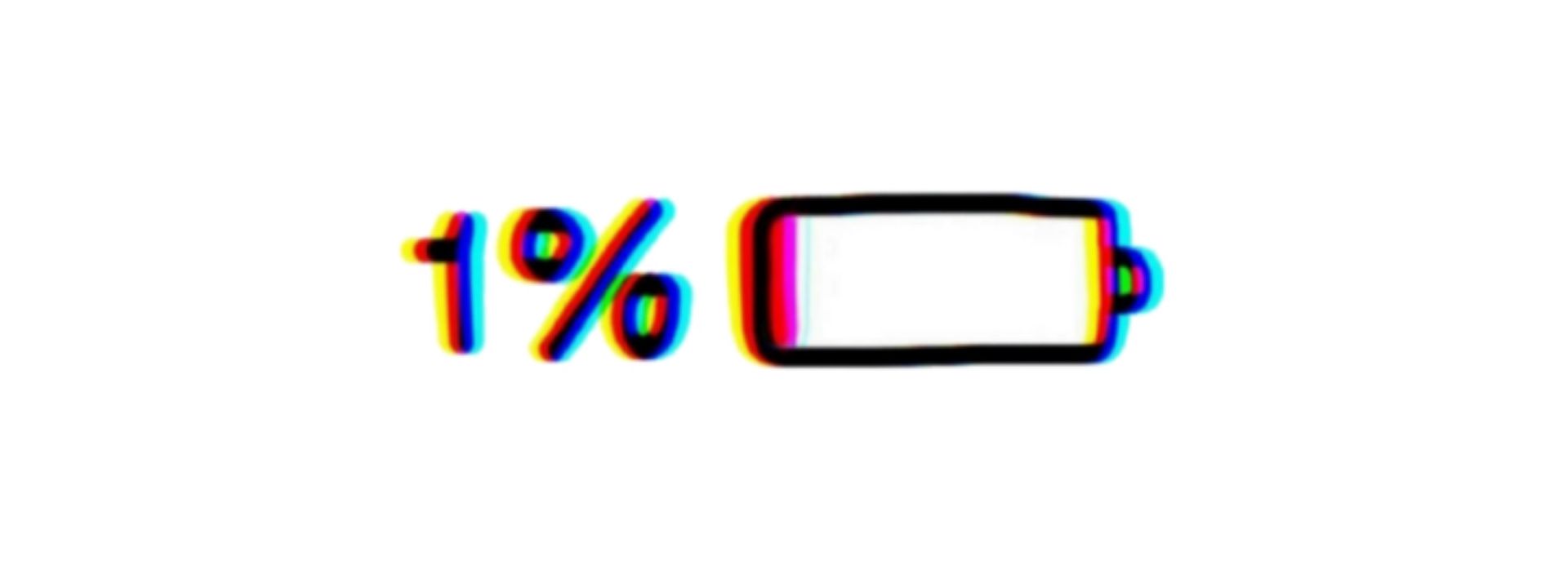
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top